Éric Bonnargent
 |
| Jason Freeny |
En 1999, au cours d’un voyage au
Mexique, Antonio Tabucchi tombe sous le charme d’un petit livre découvert par
hasard : Del Cuerpo, d’un
certain Mauricio Ortiz, docteur en médecine. Il écrit aussitôt un article pour El País dans lequel il émet le souhait
que ce livre soit publié. Depuis le mois d’avril, Du Corps est disponible en français.
Contrairement à ce que le titre pourrait
faire croire, Du Corps n’est pas un
traité, ni de philosophie ni de physiologie. Il est bien plus que cela et c’est
sans doute pourquoi il réussit à si bien dire la complexité du corps qui se
dérobe à toute tentative de définition. À la question « Qu’est-ce que le
corps ? », nous pourrions répondre à la manière de Saint Augustin à
propos du temps : si personne ne nous le demande, nous le
savons : mais que nous voulions l’expliquer à la demande, nous ne le
savons pas. Malgré l’intimité que nous partageons avec lui, nous ne savons rien
de notre corps ; il fonctionne,
c’est tout :
« De même que les globules rouges n’ont aucune notion de métrique ou de
philosophie, les besoins de l’hémoglobine demeurent totalement étrangers à la
pensée […] et nous ignorons tout des peines qu’éprouve le rein à distiller les
urines, ou de la lente poussée des cheveux dans leur follicule. »
Ne pas sentir son corps, être dans
l’ignorance de cette incroyable machinerie dans laquelle les théologiens ont
cru voir une preuve de l’existence de Dieu est la plupart du temps un signe de
bonne santé :
« la tête est creuse. Plus que des viscères, elle contient des rêves,
plus que des tissus, des pensées. […] Le cerveau n’existe que dans les salles d’opération et sur les tables
d’autopsie. »
À travers une centaine de textes de
quelques pages chacun, Mauricio Ortiz s’intéresse tantôt en médecin, tantôt en
philosophe, tantôt en poète à la complexité de notre corps afin d’en révéler
toute la richesse. Le lecteur sera frappé par la pertinence
poético-physiologique de certains phénomènes, comme celui de la danse des lumières
qui apparaissent à la surface de nos paupières lorsque nous fermons les yeux,
comme celui des battements de notre cœur ou de nos crispations musculaires. Les
sensations que nous éprouvons à notre réveil, en cas de vertige, en cas de
douleurs, forte ou légère, soudaine ou lancinante, sont tout aussi belles et
pertinentes. Mauricio Ortiz s’emploie aussi à attirer notre attention sur des
phénomènes que nous oublions tant ils sont habituels comme le souffle pourtant
si protéiforme qui nettoie les lunettes, rythme les paroles, mais peut se
transformer en haleine, forcément mauvaise, à cause du tabac ou de l’emploie de
certains mots… Le corps est parfois source de souffrance, il est malade et
meurt, mais, pour celui qui sait encore s’émerveiller, il est plus souvent
source de plaisir. Sans parler de la sexualité à laquelle l’auteur consacre la
troisième partie, qui n’a pas connu l’extase en se grattant ?
En réalité, il y a trois manières
d’appréhender le corps. Il y a d’abord le corps externe, tout en surface. Ses
limites sont impossibles à cerner. Notre corps se projette dans les paysages,
les sons et les odeurs que nous percevons. C’est pourquoi les lunettes sont,
pour celui qui en a besoin, un organe comme un autre. Comme toutes les petites
infirmités, les lunettes sont souvent le signe d’une certaine vigueur de l’âme
car elles « apparaissent aussi chez
ceux dont la vue a été beaucoup sollicitée : comme le cor au pied du
pèlerin ou le durillon dans les mains du laboureur, elles sont à la fois le
résultat et le garant d’un travail dur et constant. »
Ce corps externe est martyrisé et
plusieurs de ses manifestations sont dissimulées car considérées comme
honteuses : les bourrelets, les boutons, la transpiration, etc. Le corps
externe est un symptôme social :
« Oui, pour gagner le ciel, de nos jours, il faut un corps d’athlète, une
vocation de martyr de l’allopathie, et un attachement indéfectible à la
thérapie alternative. Il faut se plier à une diète très stricte aux saveurs les
plus fades, ingérer chaque matin drogues publicitaires et produits naturels,
s’enduire de baumes, de parfums et autres maquillages, se talquer, être un
maniaque sexuel dans le strict cadre fixé par les normes, avoir peur de tout ce
qui nous menace, et s’affranchir des vices qui nous polluent. »
L’obsession de la pureté nous conduit à
rejeter le corps interne qui est « un
corps différent, où n’entre pas la lumière, où la température est
incroyablement stationnaire, et où tout n’est que liquides et cavités
virtuelles. » Dans l’organisme, dans le monde de la chair dissimulé
par la peau se met en place une dialectique du vide et du plein. Le corps a un
besoin de se remplir et de se vider, physiquement et métaphysiquement (« La tête fait le plein d’idées et il n’y en a
que de nouvelles qui puissent la vider »). Mauricio Ortiz n’hésite pas
à consacrer de belles pages à ces réalités organiques en quête d’extériorité
dont les belles âmes répugnent à parler au nom de convenances
éthico-hygiénistes, comme les menstruations, les rôts, les pets… À propos des
mucosités et des excréments (« Fanfare » et « Caca »), le
lecteur sera surpris par la finesse drolatique avec laquelle l’auteur en parle.
Nous éprouvons une telle répugnance envers ces sujets qu’un politiquement
correct se met en place. Le sperme et le foutre, par exemple, sont deux choses
différentes pour le commun des mortels :
« Le sperme vit dans les tubes à essai et on l’analyse au microscope. Le
foutre, c’est mal, il pénètre dans le corps de l’être aimé ou imbibe le papier
hygiénique, il finit enfermé dans du latex ou flottant dans la baignoire,
desséché sur le pantalon de pyjama, odorant sur le drap, jaune sur le slip,
gluant dans la main. […] L’un est sérieux et solennel, objet de traités et de manuels,
et caractérisé par une odeur sui generis. L’autre a l’odeur du foutre, ni plus
ni moins, et il en a le goût. »
La relation entre l’extériorité et
l’intériorité est parfois très incertaine :
« L’évidence est parfois trompeuse : ainsi, les quelques mètres de
l’intestin – dont le nom veut dire intérieur, interne – sont bien
extérieurs : c’est d’ailleurs pour cela qu’ils peuvent héberger entre
leurs parois des milliers de bactéries. […] Les yeux, qui en principe sont des
organes externes, outre qu’ils sont des fenêtres qui ouvrent sur l’âme, sont,
par la même, des fenêtres à l’intérieur du corps : la rétine est déjà
interne, avec sa couronne de vaisseaux sanguins et sa trame de nerfs. […] La
lecture est externe : papier et petites lettres noires, et intérieures :
la surprise, la stupeur, l’apparition. »
Cette dichotomie entre corps externe et
corps interne est résolue et dépassée par ce que Mauricio Ortiz appelle
finalement « le corps émotionnel ».
Ce corps est fragmentaire puisqu’un « morceau
de notre âme reste avec l’ami que l’on quitte, un autre sur une terre
lointaine, un autre encore dans l’esquisse d’un tableau ou l’encre nécessaire
pour écrire un mot. D’autres fragments se perdent au cours d’une joyeuse
bringue », éprouve de la joie et souffre. Le corps émotionnel n’est
finalement rien d’autre que l’âme, changeante et contradictoire. Il y a de doux
relents nietzschéens chez Mauricio Ortiz lorsqu’il évoque la multiplicité de
notre être :
« On est marin dans le livre que nous lisons, et l’instant d’après, on se
retrouve dans le rôle austère de confesseur ; tantôt tueur sadique d’une
souris dans l’arrière-cuisine, tantôt joyeux convive chez des amis, ou encore
malheureux martyr d’une crise d’hémorroïdes. »
Plus le sujet lutte contre l’incohérence
de ses aspirations et de ses désirs, plus il tente de conquérir une illusoire
unité et plus il souffre. L’unanimité est la maladie de l’homme moderne, telle
est la leçon qu’il faut retenir de ce livre qui cache à l’intérieur de ses
pages, sous l’austérité de sa couverture une infinité de trésors :
« on aspire à l’unanimité, et, à travers elle, à l’expression maximale de
la pathologie mentale : l’homme à personnalité unique, un fou piégé au
milieu de la rivière sur sa pierre solitaire. »
Mauricio Ortiz, Du Corps. Traduit de l’espagnol (Mexique) par Roland Faye. Préface
d’Antonio Tabucchi. 18 €

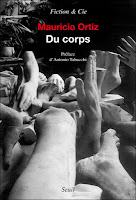
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire